4. La rationalité esthétique
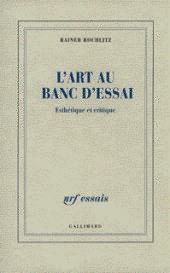
![]() OUR Rochlitz, et contrairement à Schaeffer, l'oeuvre d'art est définie par l'évaluation
qu'elle induit nécessairement. Il fait remarquer qu'une oeuvre d'art prétend à la
reconnaissance de son degré de réussite, et est ainsi susceptible d'une critique et
d'une justification argumentée (Rochlitz, 1992 : 203). "
OUR Rochlitz, et contrairement à Schaeffer, l'oeuvre d'art est définie par l'évaluation
qu'elle induit nécessairement. Il fait remarquer qu'une oeuvre d'art prétend à la
reconnaissance de son degré de réussite, et est ainsi susceptible d'une critique et
d'une justification argumentée (Rochlitz, 1992 : 203). "Parler de � rationalité esthétique �,
c'est considérer que les jugements esthétiques et les discours critiques, ceux des experts
comme ceux des profanes, obéissent aux règles d'une argumentation.
" (Rochlitz, 1998 :
152). La rationalité esthétique est un type spécifique de rationalité : cette formule "tente (...)
de définir une forme de rationalité qui ne soit applicable qu'à la validité esthétique,
analogue à la fois au vrai et au faux dans le domaine de la connaissance et à la
justesse normative dans le domaine éthique, mais irréductible à ces types de validité.
"
(idem) Etre rationnel, c'est donc prétendre "à une reconnaissance et une acceptation
justifiable
". Cela ne se limite en rien à une idée de � raison instrumentale �, de domination de
l'environnement, ni n'entraîne un assujettissement rationnel de l'art.
On a donc ici un retour en force du rôle du critique dans la définition de la relation esthétique.
Celui-ci avait été rendu secondaire par les théories empiristes de Genette et Schaeffer.
"L'oeuvre n'est livrée au public que dans la mesure o� son auteur (ou ses auteurs)
considère(nt) qu'elle peut affronter le regard critique, qu'elle mérite son attention en
raison d'une certaine signifiance. C'est cette intersubjectivité d'une reconnaissance,
recherchée et -- dans le cas de la réussite -- obtenue à des degrés divers, qui est
désignée ici par le terme de � rationalité esthétique �.
" (Rochlitz, 1992 : 204)
Alors que pour Genette et
Schaeffer, c'est ce jugement
de plaisir qui constitue le
jugement esthétique, pour
Rochlitz, il ne s'agit là que
d'un jugement de plaisir, mais
non d'un
jugement esthétique,
qui, argumenté, possède une
prétention à la validité
La réussite d'une oeuvre ne dépend donc pas du plaisir que peut éprouver un sujet à son égard. Alors que pour Genette et Schaeffer, c'est ce jugement de plaisir qui constitue le jugement esthétique, pour Rochlitz, il ne s'agit là que d'un jugement de plaisir, mais non d'un jugement esthétique, qui, argumenté, possède une prétention à la validité. Kant avait déjà fait une importante remarque à ce sujet : "il serait (...)ridicule, écrit-il, que quelqu'un, s'imaginant avoir du goût, songe à en faire la preuve en déclarant : cet objet (...) est beau pour moi. Car il ne doit pas appeler beau ce qui ne plaît qu'à lui." (CFJ, �7) Ainsi, Rochlitz attire l'attention avec Kant (quelles que soient leurs dissensions à d'autres égards) sur le fait qu'il est constitutif d'un jugement esthétique qu'il prétende valoir pour tous. De même, dit-il, qu'on n'appelle pas vraie une opinion personnelle, ou juste un point de vue partisan, on n'utilise pas le terme � beau � à propos d'un sentiment personnel (Rochlitz, 1994 : 125) : qu'on se rappelle la distinction kantienne entre le jugement d'agrément (� c'est bon �) et le jugement esthétique (� c'est beau �).
La critique d'art relève donc
d'une exigence de normativité
à laquelle échappent les
relations
basées seulement sur
le plaisir. Mais éprouver du
plaisir en un objet n'en fait
pas une oeuvre
d'art
La critique d'art relève donc d'une exigence de normativité à laquelle échappent les relations
basées seulement sur le plaisir. Mais éprouver du plaisir en un objet n'en fait pas une oeuvre
d'art. "Une oeuvre d'art dont la qualité esthétique ne peut être justifiée par aucune �
raison � n'en est pas une.
" (Rochlitz, 1992 : 206) Donc, toute relation esthétique est
nécessairement évaluative, normative : sa qualité est constitutive de la relation que l'on
entretient avec elle. L'intention artistique n'est pas suffisante. Et on se souvient que c'est ce
que prétend Schaeffer (ainsi que Genette, bien qu'il considère que cette intention doit être
reconnue par un sujet). Mais lorsque je qualifie un texte de � littéraire � en fonction soit de
propriétés (structure, � fictionnalité �...) ou même d'une intention esthétique, je n'implique là
aucune dimension évaluative, et, a fortiori, je ne la qualifie pas comme oeuvre d'art. Sinon, la
moindre nouvelle personnelle devient une oeuvre d'art, alors même qu'elle n'est reconnue
comme telle par personne. Contrairement à ce qu'affirmait Schaeffer, on ne peut parler
d'oeuvre d'art en dehors d'une évaluation des qualités de l'oeuvre.
Si je dis d'une oeuvre d'art
qu'elle est belle, je ne dis
pas seulement qu'elle me
plaît. J'énonce
un postulat (à
argumenter) dont je prétends
la validité intersubjective
Si je dis d'une oeuvre d'art qu'elle est belle, je ne dis pas seulement qu'elle me plaît. J'énonce
un postulat (à argumenter) dont je prétends la validité intersubjective. Cela est vrai pour tout
prédicat normatif : "dire qu'une chose ne peut pas -- sans contradiction dans les termes --
être � vraie �, � juste �, � sincère � ou � belle � (ou une �
"
(Rochlitz, 1994 : 126) Si donc je pose une telle affirmation, cela veut dire que j'ai des raisons
de le faire, et des arguments à opposer à la contestation. De plus, elle peut être réfutée,
comme toute affirmation rationnelle, et révisée. En formulant un jugement esthétique, je suis
donc prêt à admettre un débat à son sujet. Ceci dit, "oeuvre d'art réussie
�),
uniquement pour moi, cela signifie que ces notions mettent en jeu les intérêts de tous,
autrement dit toute la diversité des points de vue qui peuvent exister dans la société.je peux (...) reconnaître un tel
jugement sans moi-même aimer l'oeuvre en question, et sans adhérer à la vision du
monde qu'elle traduit.
" (Rochlitz, 1994 : 138)
La rationalité esthétique suppose une suspension de l'évaluation, laquelle ne pourra être
formulée qu'après avoir � analysé � correctement les caractéristiques de l'oeuvre : "pour
juger un objet dont l'identification ou la compréhension sont difficiles, il faut apprendre
de quel point de vue il est pertinent d'en juger les qualités, ce qui n'est pas la même
chose que de l'aimer ou de ne pas l'aimer.
" (Rochlitz, 1998 : 154)
Pour autant, cela ne signifie pas que le plaisir est étranger au jugement esthétique. Seulement,
celui-ci déborde largement de celui-là, exprime plus que lui. "Un produit qui prétend au
titre d'oeuvre d'art, et qui n'offre aucune sorte de plaisir (...) reste généralement au
seuil du monde de l'art et n'y entre pas.
" (Rochlitz, 1994 : 129)
Le jugement esthétique
détermine les qualités de
l'objet non pour les connaître
(à la manière d'une
connaissance scientifique),
mais pour
saisir l'ordonnance
des symboles qui évoquent les
cohérence et la richesse
suggestive
d'une vision
actualisable. (...) Décrire un
objet d'art n'est pas encore
appréhender ce
qui en fait une
configuration artistique.
Donc, la candidature à l'évaluation (ou l'intention esthétique) est insuffisante pour faire d'un
objet une oeuvre d'art. "Les galeries sont fréquemment confrontées à des candidatures
qui s'avèrent inacceptables.
" (Rochlitz, 1994 : 131) Décrire une oeuvre d'art, ce n'est pas
non plus la qualifier comme oeuvre d'art, même si ces descriptions portent sur des propriétés
d'appartenance générique (Schaeffer). Je peux mener une description stylistique d'un texte
littéraire, mais ce n'est pas la décrire comme oeuvre d'art, mais comme un ensemble signifiant
présentant telles caractéristiques textuelles. "Les critères au nom desquels un travail peut
être qualifié d'artistique ou de non artistique relèvent d'une � procédure � critique et
d'un processus d'argumentation, mais de tels critères peuvent néanmoins être
circonscrits.
" (Rochlitz, 1994 : 133) Il s'agit de dégager la structure interne de l'oeuvre, son
ambition, les enjeux qu'elle reflète, les moyens mis en oeuvre pour les aborder, le degré
auquel elle a réalisé ses exigences... "Le jugement esthétique détermine les qualités de
l'objet non pour les connaître (à la manière d'une connaissance scientifique), mais pour
saisir l'ordonnance des symboles qui évoquent les cohérence et la richesse suggestive
d'une vision actualisable. (...) Décrire un objet d'art n'est pas encore appréhender ce
qui en fait une configuration artistique.
" (Rochlitz, 1994 : 135) Le plaisir esthétique est
donc une partie seulement de la relation que nous entretenons avec l'oeuvre. A la manière de
Kant, Rochlitz affirme donc que lorsque je dis d'une oeuvre qu'elle est belle, je prétends à
l'accord des autres, et n'exprime pas seulement mon plaisir. En somme, � ceci est beau
� ne
signifie pas � ceci me plaît
� (Genette, Schaeffer) mais � ceci est réussi
�.
Les arguments esthétiques
n'ont
qu'une validité
intersubjective, mais ne
reflètent aucune doctrine,
aucun concept du beau qui
viendrait s'imposer a priori.
Ils jugent l'actualisation
effective de l'oeuvre par
rapport à ses
propres
ambitions.
Rochlitz ne renoue aucunement avec les thèses objectivistes. Les arguments esthétiques n'ont
qu'une validité intersubjective, mais ne reflètent aucune doctrine, aucun concept du beau qui
viendrait s'imposer a priori. Ils jugent l'actualisation effective de l'oeuvre par rapport à ses
propres ambitions. "Il ne peut exister de recette suivant laquelle on pourrait produire un
chef-d'oeuvre.
" (Rochlitz, 1994 : 138) Rochlitz reconnaît, comme Kant, Genette et
Schaeffer, que le jugement esthétique se fonde sur la relation que le sujet entretient avec
l'objet. "Dès qu'il y a réception esthétique, les propriétés objectives de l'oeuvre sont
interprétées et évaluées dans le cadre d'une relation dans laquelle l'ambition de l'oeuvre
est confrontée aux attentes d'un récepteur qui s'efforce de comprendre. Les qualités de
l'oeuvre ne sont pas celles de l'objet qui est son habitacle, mais celles de l'action qu'elle
exerce avec la participation du récepteur.
" (Rochlitz, 1998 : 155)
Rochlitz considère aussi
qu'un
objet doit non seulement être
évalué pour être une oeuvre
d'art, mais doit l'être
positivement.
Non seulement il refuse les thèses descriptives de Schaeffer, mais Rochlitz considère aussi
qu'un objet doit non seulement être évalué pour être une oeuvre d'art, mais doit l'être
positivement. "Même un avion qui n'est plus capable de voler garde son identité
descriptive d'avion. En revanche, un objet candidat au titre d'oeuvre et qui ne remplit
aucune des conditions minimales que l'on exige d'une oeuvre d'art (...), non seulement
�
" (Rochlitz, 1994 : 142) Une oeuvre d'art
cesse d'en être une dès lors qu'elle n'est pas à la hauteur de sa prétention à la validité.n'est pas capable de voler
�, mais � n'est pas un avion
�. L'évaluation négative lui
fait perdre le caractère descriptif d'oeuvre d'art.
A cela, Schaeffer, qui tient que le statut d'oeuvre d'art ne dépend que de ses propriétés descriptives, et non évaluatives, répond qu'il est curieux qu'un objet non artistique garde son identité descriptive (être un avion) même s'il n'est pas réussi, alors que l'oeuvre d'art fait mystérieusement exception à cette règle. (Schaeffer, 1996 : 187) Il ne conteste aucunement la présence d'une dimension évaluative dans la relation ; il conteste juste qu'elle soit définitoire de l'oeuvre d'art. En fait, il fait remarquer qu'elle est présente dans un grand nombre des rapport avec nos objets, mais cela n'est qu'une conséquence triviale du statut téléologique de ces objets, autrement dit qu'ils sont censé remplir une fonction qu'on leur attribue selon nos désirs et besoins.
Pourtant, une cuillère ratée, c'est-à-dire qui ne peut fonctionner comme cuillère, n'est pas une
cuillère sans quoi, à la limite, un râteau est une cuillère ratée. Schaeffer prétend même qu'une
mayonnaise qui n'a pas pris est une mayonnaise : "certes, il ne suffit pas de vouloir
préparer une mayonnaise pour que le résultat soit effectivement une mayonnaise. En
revanche ce qui est exigé pour qu'un produit donné soit une mayonnaise, ce n'est pas
qu'il soit réussi, mais qu'on prenne de l'huile et des jaunes d'oeufs, qu'on essaie de les
mélanger et qu'en fin d'opération on ajoute un filet de vinaigre, autrement dit, qu'on
utilise les matériaux de départ pertinents et qu'on entreprenne les actions � opérales �
pertinentes.
" (Schaeffer, 1996 : 188) Cette affirmation me semble parfaitement erronée !
Une mayonnaise ratée n'est pas une mayonnaise ! Cependant, et c'est là qu'on trouve un
problème, si je vais dans une galerie d'art et que je prétends qu'un tableau est raté, je ne le
disqualifie pas ipso facto comme oeuvre d'art. Donc, Schaeffer aurait quand même raison en
considérant que le statut d'oeuvre d'art ne dépend pas de sa valeur effective. Pourquoi cette
différence apparente de statut ?
si je dis qu'une oeuvre d'art
est ratée, elle reste
effectivement une oeuvre
d'art. Mais si tout le monde
décrète l'échec de l'oeuvre
(ou plutôt,
l'objet qui est
encore à reconnaître comme
oeuvre), alors elle est
effectivement disqualifiée
comme oeuvre
La solution, selon moi, tient en ceci : si je dis qu'une oeuvre d'art est ratée, elle reste effectivement une oeuvre d'art. Mais si tout le monde décrète l'échec de l'oeuvre (ou plutôt, l'objet qui est encore à reconnaître comme oeuvre), alors elle est effectivement disqualifiée comme oeuvre. L'histoire de l'art regorge d'exemple d'artistes dont l'oeuvre n'était au départ nullement considérée comme artistique, même si un accord s'est ensuite dégagé pour l'accepter. De plus, lorsqu'une oeuvre est évaluée comme un échec, elle tombe dans l'oubli, elle sort du monde de l'art ; on ne continue pas à parler d'une mauvaise oeuvre d'art -- sauf, à la limite, comme exemple d'échec, comme le film "Plan 9 From Outer Space" d'Edward Wood, mais dans ce cas, on n'en parle précisément pas en tant qu'oeuvre d'art. Pour reprendre le terme de Goodman, elle cesse de fonctionner comme oeuvre d'art. En fait, il faut nous rappeler que, selon Rochlitz, l'oeuvre d'art prétend à une validité intersubjective. Et c'est ce que me semble avoir ignoré Schaeffer. La thèse selon laquelle un objet doit être positivement apprécié pour être une oeuvre d'art ne prétend nullement que c'est le sujet qui opère cette qualification par quelque obscure autorité. Mais la position que défend Schaeffer, selon laquelle l'oeuvre d'art se définit exclusivement par des propriétés descriptives, indépendamment de l'évaluation, me paraît totalement fausse. C'est poser un argument d'autorité à l'encontre de l'usage courant, et les propriétés descriptives n'ont alors de valeur que par pétition de principe. En effet, comme je viens de le dire, on refuse constamment la qualité d'oeuvre d'art à des objets que l'on ne juge pas dignes de ce nom. Sans cela, le débat très commun sur le cinéma qui oppose films d'art de divertissement n'aurait pas de raison d'être ; or, un film de divertissement, même très réussi de ce point de vue, est souvent considéré mauvais comme oeuvre d'art (enjeux insignifiants, apport nul au champ artistique...). L'argument � descriptiviste � de Schaeffer pose autoritairement la futilité de ce débat, au nom de la théorie esthétique qui devrait plutôt l'expliquer.
Dans le cas de l'oeuvre d'art,
par
contre, cette évaluation
ne peut aboutir que dans un
débat à l'acception de l'objet
comme
oeuvre d'art ; le sujet,
lui, peut bien se contenter de
sa reconnaissance personnelle
de
l'intention esthétique (ou
de la candidature à
l'évaluation) pour considérer
l'objet comme
oeuvre d'art (et
l'évaluer), mais cela reste
insuffisant pour la
collectivité.
Pourquoi alors, pour répondre à Schaeffer, en va-t-il autrement des objets non artistiques (avions, cuillers, râteau, mayonnaise...) ? Tous ces objets ont, comme l'oeuvre, un statut téléologique. Les buts que les objets cités doivent remplir sont d'ordre utilitaire. Le but d'une oeuvre d'art est autre : répondre à des enjeux, présenter une ambition, et donc se donner les moyens de parvenir à la réussite. Or, l'oeuvre d'art, soumise à la rationalité esthétique, prétend être reconnue intersubjectivement. Les objets utilitaires, eux, sont reconnus objectivement comme remplissant leur fonction. On discute en ce qui concerne la qualité d'une oeuvre, mais on n'a pas besoin de mener un débat pour évaluer la � réussite � d'une brosse pour toilettes, évaluation qui peut se fonder sur un concept purement objectif -- la capacité effective de la brosse à nettoyer les toilettes. Dans le cas de l'oeuvre d'art, par contre, cette évaluation ne peut aboutir que dans un débat à l'acception de l'objet comme oeuvre d'art ; le sujet, lui, peut bien se contenter de sa reconnaissance personnelle de l'intention esthétique (ou de la candidature à l'évaluation) pour considérer l'objet comme oeuvre d'art (et l'évaluer), mais cela reste insuffisant pour la collectivité.
le
jugement esthétique dans
son ensemble dépasse le
jugement simplement subjectif
En somme, l'analyse de Schaeffer, bien qu'elle soit ici erronée, me semble pertinemment
rappeler l'existence d'un jugement subjectif et individuel, que Rochlitz a quelque peu tendance
à oublier. Par contre, ce dernier a parfaitement raison d'attirer l'attention sur le fait que le
jugement esthétique dans son ensemble dépasse le jugement simplement subjectif, ce que
Schaeffer, de son côté ignore. Rochlitz écrit : "tout jugement énoncé cherche à dépasser la
préférence idiosyncrasique et prétend donc à une validité intersubjective, sans que
cette prétention soit par définition illusoire ; elle peut évidemment l'être dans les faits.
"
(Rochlitz, 1998 : 164) Inversement, je peux aussi reconnaître les qualités d'une oeuvre sans
pour autant éprouver le moindre plaisir subjectif. Au pire mon jugement manquera-t-il de
motivation.
C'est donc
par référence à
cette idée indéterminée (...)
qu'il est possible de �
discuter � du goût et
d'élargir la sphère de la
subjectivité pure pour
envisager un partage non
dogmatique
de l'expérience
esthétique avec autrui en tant
qu'il est un autre homme.
Rochlitz retrouve ici la solution kantienne à l'antinomie du goût (CFJ, �57). Il reprend deux
caractères opposés du goût, relevés par Kant : d'une part, "il est sans concept (sans
preuve, sans généralité), mais d'autre part le jugement esthétique manifeste le genre de
régulation que l'on pourrait attribuer à un concept.
" (Khodoss in Kant, 1955, 76) Ce
sont donc ici les deux versants de la dialectique kantienne que Rochlitz tente lui aussi de
surmonter, selon lesquels l'art se fonde ou non sur des concepts (CFJ, � 55). La solution
proposée par Kant relève au fond de la même intention que celle de Rochlitz : le dépassement
de la subjectivité. Selon Kant, pour lever l'antinomie des deux propositions contradictoires, il
faut distinguer deux sens différents de concept : tantôt on entend ce terme comme un concept
de la connaissance, scientifique, tantôt comme un concept indéterminé de la raison. Ainsi, on
ne peut apporter aucune preuve d'un jugement esthétique, mais on est cependant fondé à en
discuter, car on peut se référer à des Idées transcendantales. "Tout en étant l'objet d'un
sentiment particulier et intime, la beauté éveille les Idées de la raisons qui sont
présentes en tout homme -- ce par quoi elle peut transcender la subjectivité particulière
et susciter un sens commun (les Idées � éveillées � par l'objet beau étant en principe
communes à l'humanité).
" (Ferry, 1990 : 74) On n'est pas loin du principe de rationalité
esthétique permettant une prétention à la validité intersubjective, c'est-à-dire à un jugement
partageable et universellement valable. Au-delà de la subjectivité à laquelle on s'est trouvé
réduit chez Genette et Schaeffer, on trouve ici l'ouverture vers un dépassement nécessaire de
l'expérience personnelle grâce à un principe rationnel transcendantal. Ferry écrit plus loin : le
jugement de goût "ne se borne pas à renvoyer à la pure subjectivité empirique du
sentiment parce qu'il repose sur la présence d'un objet qui, s'il est beau (...) éveille une
idée nécessaire de la raison qui, en tant que telle, est commune à l'humanité. C'est donc
par référence à cette idée indéterminée (...) qu'il est possible de � discuter � du goût et
d'élargir la sphère de la subjectivité pure pour envisager un partage non dogmatique
de l'expérience esthétique avec autrui en tant qu'il est un autre homme.
" (Ferry,
1990 :127)
Il y a en effet un désir inhérent à l'expérience esthétique de la partager, d'o� l'existence et l'importance du débat critique. Elle est d'abord subjective et muette, passe par des observations, descriptions, interprétations, auxquelles s'appliqueront des prédicats, qui seront l'objet d'une argumentation dans le débat. Une expérience esthétique ne peut donc être pleinement satisfaisante que dans la mesure o� elle est l'objet d'un jugement réfléchi. La limiter, à la manière de Genette, à la seule expérience individuelle, c'est donc la priver d'une dimension essentielle qui lui donne son entière valeur.
le débat critique a permis de
converger vers certains
paramètres sur lesquels on
peut discuter de la qualité
d'une oeuvre d'art, et sur
lesquels,
donc, s'appliquent
les arguments
Si l'on ne peut prétendre, comme le faisait Hume, qu'il y a de bons juges, les autres étant
empêchés pour des raisons diverses, certaines personnes appuient leurs jugements, qui
dépasse la simple préférence personnelle, sur des meilleures raisons que d'autres. S'il n'y a
pas de doctrine du beau, si celui-ci ne peut être défini à partir de propriétés nécessaires et
suffisantes de l'objet, Rochlitz relève que le débat critique a permis de converger vers certains
paramètres sur lesquels on peut discuter de la qualité d'une oeuvre d'art, et sur lesquels,
donc, s'appliquent les arguments. Ils ne sont pas des critères définitifs qui permettent de
séparer radicalement le bon grain de l'ivraie, mais jouent comme repères pour l'évaluation de
l'oeuvre. "Ce qui tranche à la place des critères absolus et universels qui n'existent pas,
ce sont les raisons invoquées par des jugements singuliers qui ne tirent leur force que
de leur acceptabilité indépendante des préférences de celui qui les porte. (...) C'est
donc, chaque fois, un faisceau d'arguments qui motive le jugement favorable ou
défavorable.
" (Rochlitz, 1998 : 191)
Parmi ces paramètres d'évaluation, la notion d'unité revient couramment au cours de l'histoire. Pour éviter qu'on la confonde avec une idée d'unité purement formelle (trois unités, unité de ton, de formes...) qui a été largement battue en brèche par l'art moderne, Rochlitz parle de cohérence.
Par ce terme, il entend une idée plus large. Une oeuvre d'art n'est pas uniquement liée au
monde par simple référence (représenter quelque chose), mais elle réfère aussi à elle-même.
De plus, elle se distingue des autres objets du monde, en tant, précisément, qu'oeuvre d'art.
La cohérence est ce qui garantit sa nature auto-référentielle et distincte, et ainsi son efficacité :
"sans elle, qui peut prendre des formes diverses, il n'y aurait guère d'efficacité d'une
oeuvre d'art. Or, celle-ci joue, au niveau de la sollicitation de l'attention, le rôle de
stimulant de l'intérêt que joue, d'ordinaire, l'utilité immédiate ou médiate des objets.
"
(Rochlitz, 1998 : 192)
Elle définit le fait qu'une oeuvre, au lieu de se disperser, présente des caractéristiques
convergentes dans le but de d'atteindre la signification qu'elle ambitionne de proposer. Mais
une de ces caractéristiques peut justement être d'être chaotique : "pour être un acte ou une
performance, une oeuvre, dans la pluralité de ses éléments, doit avoir une sorte de
cohérence. S'il n'y avait pas en elle -- quel que soit par ailleurs son caractère
déstructuré, chaotique ou déséquilibré -- une ordonnance, une direction, ou une
tendance déterminées, elle ne pourrait d'aucune manière agir dans un sens déterminé,
mais se présenterait comme un ensemble de propriétés dépourvues d'orientation ; elle
pourrait être un objet ou un groupe d'objet, mais non une oeuvre.
" (Rochlitz, 1998 :
194)
La cohérence, ce n'est donc pas simplement le fait d'être unifié. C'est être homogène, cohérent avec le propos qui est présenté. Elle n'est même pas spécifique à l'art. Non seulement n'importe quel travail intellectuel doit être cohérent pour être réussi, mais aussi n'importe quel objet utilitaire. La différence entre la cohérence esthétique et ces types de cohérence est qu'elle ne répond pas à des règles épistémiques ou pratiques.
Il ne s'agit pas, il faut le répéter, d'une condition absolue et suffisante. La cohérence ne
s'estime qu'en termes de degré, et ne fonctionne comme paramètre qu'en vertu de la valeur
que le débat critique lui accorde, et non d'une logique de propriétés nécessaires et suffisantes.
Elle ne peut même être définie une fois pour tous. L'exigence de cohérence varie dans
l'histoire : une oeuvre cohérente à un moment de l'histoire ne l'est pas à un autre ; la
cohérence d'un mouvement artistique n'est pas la même que celle d'un autre. De plus, n'étant
pas suffisante, il faut en tenir en compte en corrélation avec d'autres paramètres, car elle n'est
pas une fin en soi. Une oeuvre peut être parfaitement cohérente, voir unifiée, mais être
néanmoins d'une totale platitude. "Il faut donc qu'il y ait quelque chose dont la mise en
évidence nous importe ; il faut qu'une oeuvre d'art ait un enjeu qui en vaille la peine et
qui focalise l'intérêt, sans quoi la cohérence d'une forme géométrique proprement
tracée, d'un alignement de phrases grammaticalement irréprochables, suffirait à fonder
la valeur de l'art.
" (Rochlitz, 1998 : 201)
La cohérence d'une oeuvre garantit son efficacité esthétique, mais il n'y aurait pas d'efficacité
si ce n'était celle de quelque chose que l'oeuvre présente. D'autres paramètres entrent en jeu.
Aucun d'eux, ni seul, ni avec d'autres, ne peut être déterminant pour justifier un jugement,
sinon on se trouverait en présence d'un concept de ce que doit être une bonne oeuvre. Mais
sans eux, il serait impossible de jamais défendre un jugement. Dans son dernier ouvrage,
Rochlitz utilise le terme � paramètre � plutôt que � critère �, comme précédemment, pour
marquer qu'il ne sont pas fixes, définitifs, tranchants, déterminants. "Il est impossible de
donner une réponse générale à la question de ce que l'on peut attendre d'une oeuvre,
car il existe de multiples fa�ons de réussir et d'échouer, sans que l'échec ou la réussite
relèvent, purement et simplement, de la relativité des appréciations.
" (Rochlitz, 1998 :
211)
Selon Rochlitz, on pourrait dire qu'actuellement, on juge les oeuvre selon trois paramètres
essentiels (mais d'autres peuvent encore intervenir) : l'efficacité de l'oeuvre avec laquelle elle
met en évidence ce qui lui importe de faire apparaître, ce qui lui semble digne d'intérêt ;
l'enjeu dont elle témoigne, "qui justifie l'effort entrepris
" ; la qualité exploratoire,
c'est-à-dire la nouveauté, l'originalité, l'apport qui est le sien au champ de l'art. Mais toutes
ces exigences se justifient dans le débat critique par le recours à des prédicats artistiques.
(Rochlitz, 1998 : 212) A leur sujet, Rochlitz fait une analyse finalement très proche de celle
menée par Genette, distinguant entre une part appréciative et une part descriptive. Je ne
reprendrai donc pas ici cet exposé.