3. Jugement de valeur et réussite opérale
Note : dans ce texte, je me référerai, avec Schaeffer, à la notion d'intentionnalité. Celle-ci est issue de la phénoménologie, et a été redéveloppée dans les années 80 par le philosophe américain John Searle dans l'Intentionalité : essai de philosophie des états mentaux (Paris, Minuit). Elle désigne le fait, pour la conscience, d'être toujours à propos de quelque chose : désirer quelque chose, supposer quelque chose, affirmer quelque chose... Il ne faut donc pas la confondre avec le sens commun d'intention, qui n'est qu'un type d'état Intentionnel. On écrit dès lors généralement Intentionnalité avec un majuscule pour désigner ce sens particulier.
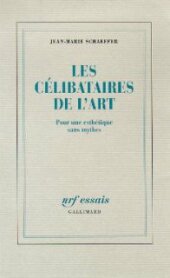
![]() ANS L'art de l'âge moderne, Jean-Marie Schaeffer (1992) menait une étude critique
très précise de ce qu'il appelait la théorie spéculative de l'art. Par ce terme, il
qualifiait une conception théorique se développant à la suite de Kant, dans le
mouvement romantique. Elle cherchait une hypothétique essence de l'art qui pût prendre une
valeur normative à l'égard de celui-ci. Avec Les célibataires de l'art (1996), il prolonge sa
réflexion en tentant de dégager l'esthétique de la philosophie de l'art.
ANS L'art de l'âge moderne, Jean-Marie Schaeffer (1992) menait une étude critique
très précise de ce qu'il appelait la théorie spéculative de l'art. Par ce terme, il
qualifiait une conception théorique se développant à la suite de Kant, dans le
mouvement romantique. Elle cherchait une hypothétique essence de l'art qui pût prendre une
valeur normative à l'égard de celui-ci. Avec Les célibataires de l'art (1996), il prolonge sa
réflexion en tentant de dégager l'esthétique de la philosophie de l'art.
Quatre points doivent être éclaircis pour éviter cette confusion entre les deux disciplines.
D'abord, "pour des raisons qui tiennent à l'histoire récente des sociétés occidentales,
lorsque nous disons � esthétique � nous pensons à � oeuvre d'art �. Cette identification
fallacieuse tire sa plausibilité superficielle d'une conception naïve de la notion d'oeuvre
d'art qui l'identifie à celle d'artefact esthétique.
" (Schaeffer, 1996 : 14) Or, d'après
Schaeffer, la fonction esthétique n'est pas une condition nécessaire et suffisante de la définition
d'oeuvre d'art pour la seule raison que le concept d'oeuvre d'art est trop flou pour qu'on
puisse en dégager une telle condition. Schaeffer en effet donnera plus loin (p.111 sq.) une
définition de l'oeuvre d'art comportant quatre conditions, dont seule la première est nécessaire
(mais non suffisante). Cette condition (ou � propriété absolue �) est qu'il doit s'agir d'un objet
issu d'une causalité Intentionnelle (autrement dit être une production renvoyant à quelque
chose) (1). Les trois autres conditions peuvent être plus ou moins présentes, voire absentes :
l'appartenance générique (appartenir à un genre admis comme artistique, c'est à dire par
exemple, présenter la structure d'un sonnet) ; l'intention esthétique (être produit dans
l'intention de faire une oeuvre d'art) ; l'attention esthétique (être considéré par un sujet comme
une oeuvre d'art). Ainsi, le fait d'être produit dans l'intention d'être une oeuvre d'art fait d'un
objet (issu d'une causalité Intentionnelle) ipso facto une oeuvre d'art (2). Or, il me semble
abusif de dire que si je tente d'écrire un poème, sans que personne n'y accorde la moindre
attention (esthétique), il est une oeuvre d'art. Je reviendrai sur la question avec l'examen des
thèses de Rainer Rochlitz. J'ajoute qu'un autre argument posé par Schaeffer consiste à dire
que dans de nombreuses cultures, certaines oeuvres d'art n'ont aucune fonction esthétique,
mais seulement magique, ou religieuse. Mais son erreur, selon moi, tient en ce que ces objets,
précisément, ne sont pas des oeuvres d'art, mais des objets magiques ou religieux. Ils
présentent certainement des traits qui peuvent avoir pour nous une valeur esthétique. Ils
peuvent donc prendre pour nous le statut d'oeuvre d'art, et ce parce qu'ils acquièrent une
fonction esthétique. Mais elle pouvait très bien être absente dans la culture d'origine, et n'y
être précisément pas une oeuvre d'art. Pour accepter dans ce cas qu'elle y ait un statut
d'oeuvre d'art, il faudrait aussi accepter les quatre conditions de Schaeffer, que l'exemple
tente justement de justifier, dans une démarche circulaire.
l'appréciation esthétique
n'est
pas due à des propriétés
de l'objet, mais uniquement à
la relation que le sujet
entretient avec
lui
Deuxième point à éclaircir : "ne pas faire la distinction entre l'artistique et l'esthétique
nous condamne à une confusion entre ce qui revient à l'oeuvre et ce qui est dû à la
relation que nous entretenons avec elle.
" (Schaeffer, 1996 : 15) Nous retrouvons ici l'idée
de Genette, bien connue depuis Kant (et à laquelle je souscris) : l'appréciation esthétique n'est
pas due à des propriétés de l'objet, mais uniquement à la relation que le sujet entretient avec
lui (3). D'ailleurs, une relation, pour être esthétique, ne requiert aucunement une oeuvre d'art :
elle peut s'appliquer à tout type d'objet. De plus, selon Schaeffer, la relation esthétique
"délimite une conduite anthropologique spécifique et possède donc un mode d'existence
transculturel.
" (Schaeffer, 1996 : 16) Contre Kant, il affirme aussi que la relation esthétique
est cognitive puisqu'elle est une forme d'attention au monde (4), et qu'elle est intéressée,
puisqu'on la veut satisfaisante (5).
Troisième point : le jugement esthétique n'a rien de central dans la relation esthétique. Si une relation esthétique comporte bien une part de jugement, celui-ci ne définit nullement celle-là. Ce n'est ni son but, ni son essence. Par ailleurs, les valeurs esthétiques sont purement relatives, et ne sont pas spécifiées par l'objet sur lequel elles sont portées. On verra que Rochlitz -- que je suivrai sur ce point -- se porte radicalement en faux par rapport à cette idée.
que les valeurs soient
relatives n'entraîne pas
l'absence de toute rationalité
dans la
relation esthétique
Enfin, que les valeurs soient relatives n'entraîne pas l'absence de toute rationalité dans la
relation esthétique : "le fait que le jugement esthétique soit subjectif n'implique nullement
que l'attention esthétique soit non amendable. La validité intersubjective de la conduite
esthétique -- comme celle de n'importe quelle autre relation cognitive -- se joue non pas
au niveau de l'appréciation et de l'évaluation, mais à celui de l'attention.
" (Schaeffer,
1996 : 18) Ce n'est donc pas le jugement qu'on amende, mais la manière de voir l'objet.
Au terme d'une analyse à la lumière de la théorie de l'Intentionnalité de Searle, Schaeffer définit la � conduite esthétique � comme une conduite spécifique, dont la spécificité ne passe pas par quelque relation spéciale aux choses différente de la relation cognitive mais par le fait qu'elle devient le support d'une � (dis)satisfaction � immanente. (Schaeffer, 1996 : 184)
Son analyse du jugement repose
sur
une distinction, quelque
peu ignorée par Genette, et
pourtant fondamentale : celle
entre le
(dé)plaisir (ou
appréciation chez Schaeffer)
et le jugement esthétiques, le
second (qui est un
jugement de
valeur) étant la
verbalisation du premier
Ainsi, chez Schaeffer, la question du plaisir (il préfère parler de satisfaction) prend une importance centrale, en acquérant une valeur autonome. Son analyse du jugement repose sur une distinction, quelque peu ignorée par Genette, et pourtant fondamentale : celle entre le (dé)plaisir (ou appréciation chez Schaeffer) et le jugement esthétiques, le second (qui est un jugement de valeur) étant la verbalisation du premier.
Quatre points sont abordés par Schaeffer pour expliciter cette distinction : la relation entre appréciation (au sens de (dis)satisfaction) et jugement esthétiques (1) ; le statut de la valeur (2) ; le statut du jugement (sa nature logique) (3) ; la spécificité du jugement esthétique (4).
(1) La différence entre l'appréciation et le jugement esthétique tient en leur nature Intentionnelle : l'appréciation est un état Intentionnel, alors que le jugement est un acte Intentionnel, un acte judicatoire qui porte sur l'état de plaisir exprimé par l'appréciation. Celle-ci est interne à l'attention esthétique, puisqu'elle est induite par celle-ci, et qu'elle peut éventuellement en motiver la reconduction. Le jugement, lui, est extérieur à l'attention esthétique, puisqu'il en est le résultat. Confondre appréciation et jugement, c'est non seulement confondre état et acte, mais c'est aussi ne pas reconnaître que le jugement esthétique comme acte Intentionnel a comme contenu propositionnel l'appréciation esthétique elle-même (qui, elle, renvoie à l'objet de l'attention). C'est l'objectivation du jugement esthétique, analysée par Genette, qui amène à croire que le jugement porte directement sur l'objet. (Schaeffer, 1996 : 202-203)
Dire qu'un objet possède telle
ou
telle valeur n'est donc
qu'un raccourci pour dire
qu'il prend cette valeur pour
tel
individu ou tel groupe
humain dans le cadre d'une
relation instrumentale
quelconque.
(2) La valeur n'est pas une propriété objectale, mais relationnelle : "elle naît de la rencontre
d'un objet (...) et de l'intérêt que quelqu'un lui porte. Dire qu'un objet possède telle ou
telle valeur n'est donc qu'un raccourci pour dire qu'il prend cette valeur pour tel
individu ou tel groupe humain dans le cadre d'une relation instrumentale quelconque.
"
(Schaeffer, 1996 : 208) Les valeurs sont donc relatives uniquement à celui qui les pose et au
type d'intérêt qu'il leur porte. "La valeur d'une oeuvre d'art ne saurait être que la valeur
instrumentale -- esthétique ou autre -- qu'elle possède pour le sujet qui la crée ou pour
celui qui l'appréhende.
" (Schaeffer, 1996 : 209) C'est donc la thèse subjectiviste-relativiste
qui est réaffirmée ici, contre l'esthétique objectiviste.
(3) La nature logique du jugement de valeur se définit par deux traits : le jugement exprime une relation intéressée entre un sujet et un objet ; il prend la forme judicatrice de l'attribution d'un prédicat de valeur à l'objet. Il se distingue donc de trois autre types de jugements qui lui ressemblent :
- Lorsque je dis : �
j'aime x
�, je ne porte pas un jugement de valeur, puisque je ne prédique rien à propos de x. Je ne fais qu'exprimer un état mental. - Lorsque je dis : �
j'aime x parce que y
�, il ne s'agit pas non plus d'un jugement de valeur, mais d'une explication causale d'un état mental. Je ne cherche pas des raisons pour justifier mon appréciation, mais des causes pour l'expliquer. Dans le cas d'une justification (jugement de valeur), il s'agit de prédiquer des traits objectaux tels qu'ils causent � légitimement � cette appréciation. Ainsi, si je dis : �cette sculpture me plaît parce qu'elle est imposante
�, je dis en fait �cette sculpture me plaît parce qu'elle est belle et elle est belle parce qu'elle est imposante
�. Seul le dernier membre de la phrase est un jugement de valeur. - Enfin, le jugement de valeur se distingue du jugement de réussite opérale, dont il sera question plus loin, et qui est un jugement d'adéquation téléologique. En gros, il s'agit de juger si une oeuvre se donne le moyens requis pour atteindre son objectif. Il n'y a là aucun intérêt en jeu : je peux juger d'une telle adéquation, et, du reste, n'en avoir que faire. Par contre, je ne peux dire qu'une oeuvre est belle sans aussi y avoir un intérêt (pour peu que j'exprime une satisfaction, ce que ne fait pas directement un jugement de réussite opérale).
(4) La spécificité du jugement esthétique repose en ce qu'il est parfaitement individuel, voire
solipsiste. Il ne met en jeu que les intérêts personnels du sujet. En cela, il se distingue d'autre
types de valeurs, qui ont un statut public : "lorsque la valeur que j'accorde à un objet est
une valeur publique ou, pour le dire autrement, lorsque je valorise l'objet au nom d'un
intérêt collectif que j'assume, mon jugement, bien que relatif à l'intérêt qu'il exprime,
n'est pas un jugement subjectif parce que l'intérêt qu'il exprime n'est pas mon intérêt
dans sa singularité.
" (Schaeffer, 1996 : 214). Or, à mon sens, cette description s'applique
parfaitement au jugement esthétique. Nous sommes constamment, dans le choix de nos
valeurs, soumis à l'influence de la collectivité à laquelle nous appartenons, et les jugements
esthétiques n'y échappent pas (pour quelle mystérieuse raison le feraient-il ?). En fait, il est
tout simplement absurde de parler de jugement de valeur solipsiste : une valeur est ce qu'elle
est précisément parce qu'elle est publiquer. Certes, les jugements divergent, mais je le
rappelle, ils convergent aussi, et l'une des raisons essentielles d'une telle convergence est que
nous partageons des valeurs commune, y compris dans le domaine de l'esthétique (6). Une
telle culture, en un lieu et un moment donné, peut apprécier tel trait esthétique, que telle autre
culture ne reconnaîtra pas, et chaque membre de ces cultures assumera le jugement de valeur.
Bien sûr, il est toujours possible pour un individu de se départir de ces jugements, mais cela
reste, au départ, marginal. Par la suite, ce refus peut s'étendre à la collectivité ; cela se passe
même sans cesse, et c'est cela qui la fait évoluer. Pour autant, on ne peut pas affirmer que
tout jugement de valeur esthétique est solipsiste. Et quand bien même un jugement se
différencie de ceux de la collectivité, il se définit toujours par rapport eux.
Curieusement, Schaeffer admet plus loin (228-232) l'existence d'une telle influence : "notre
individualité et le degré de marge de manoeuvre par rapport aux conditionnements
extérieurs résident peut-être davantage dans l'entrecroisement des innombrables
conditionnements qui nous ont fa�onnés et continuent de nous fa�onner que dans
quelque autonomie originaire qu'il s'agirait ensuite de maintenir pure dans l'expérience
esthétique.
" (Schaeffer, 1996 : 232). Si je comprends bien, il soutient que ces déterminations
ou conditionnements jouent comme � facteurs causals � de l'appréciation (satisfaction)
esthétique, qui précède le jugement de valeur (et qui en est le contenu propositionnel), lequel
en est donc indépendant. Pourtant, il me semble que s'il devait effectivement y avoir un
solipsisme absolu, il jouerait sur l'appréciation, qui est un sentiment, plutôt que sur le
jugement, qui est un acte Intentionnel conscient, et donc plus directement soumis aux usages
culturels -- ce qu'on détaillera dans la section suivante, et par quoi on retrouve ma proposition
de considérer le plaisir comme privé et le jugement comme public. Mais quand bien même
cette thèse quelque peu sophistique serait valide, il n'en reste pas moins que les valeurs
esthétiques sont, comme toutes les valeurs, culturellement déterminées.
dans la mesure o� cette
relation vise à une
satisfaction inhérente, elle
est nécessairement
intéressée
dans cette satisfaction
elle-même. Un jugement
esthétique qui serait
désintéressé
serait dénué de
sens : il ne pourrait être un
jugement de valeur
On voit que dans son analyse du jugement de valeur, Schaeffer s'oppose nettement à Kant, et à son affirmation du désintéressement de la relation esthétique. Pour Schaeffer, au contraire, dans la mesure o� cette relation vise à une satisfaction inhérente, elle est nécessairement intéressée dans cette satisfaction elle-même. Un jugement esthétique qui serait désintéressé serait dénué de sens : il ne pourrait être un jugement de valeur. (Schaeffer, 1996 : 217)
La question qui peut aussi se poser à propos des jugements esthétiques est de savoir pourquoi on ne pourrait pas juger les oeuvres selon des critères d'adéquation téléologique, c'est-à-dire pourquoi on ne pourrait évaluer -- voire mesurer -- les propriétés objectales de l'oeuvre en fonction des objectifs qu'elle prétend atteindre. Et pourquoi, dans un second temps, ne pourrait-on pas valoriser les oeuvres réussies selon ces critères (autrement dit, fonder épistémiquement un jugement esthétique sur un jugement de réussite opérale) ? Dans ce cas, on aurait bien un jugement de valeur objectif sur l'oeuvre. La réponse à la question est que l'on peut bien sûr faire cela, mais le jugement porté n'est pas pour autant esthétique. Voyons cela un peu plus en détail.
Schaeffer relève deux types de jugement de réussite opérale :
- La réussite technique : on évalue l'oeuvre par rapport à ce qu'elle devrait être (selon
une "
finalité posée en amont
"). C'est un jugement d'expertise, et non un jugement esthétique, car je ne dis rien sur la relation que j'entretiens avec l'oeuvre. De plus, comme on l'a vu plus haut, ce n'est même pas un jugement de valeur, car il ne s'y exprime aucun intérêt relatif à l'objet. Je peux juger une oeuvre techniquement réussie et y être complètement indifférent. Par ailleurs, on aurait tort d'attendre un accord nécessaire de tels jugements : certaines techniques artistiques (par exemple, cinématographiques) sont trop complexes pour être évaluées selon une échelle qui fonctionnerait comme standard. De plus, il est parfois difficile de faire la différence entre inaptitude technique et écart volontaire (o� l'oeuvre est techniquement ratée, mais téléologiquement réussie). - La réussite téléologique : on évalue l'oeuvre selon sa capacité à remplir les fonctions qu'elle est censée remplir (essentiellement apporter du plaisir). Il y a deux types d'arguments : un argument statistique, d'après lequel une oeuvre est d'autant plus réussie qu'elle suscite de réactions positives (mais alors, plus un film a de succès, meilleur il est, et inversement !) ; un argument � subjectif �, qui postule qu'une oeuvre est réussie parce qu'elle me plaît. Mais un argument subjectif n'est pas un argument (qui doit être intersubjectivement valable). En fait, j'exprime mon appréciation, et j'en déduis la réussite. Ce n'est donc pas un jugement de réussite opérale, mais déjà un jugement esthétique.
En théorie, donc, les jugements de réussite opérale et esthétique sont bien distincts. En pratique, on apprécie une oeuvre pour des raisons objectives, par exemple pour le savoir-faire de l'artiste dont elle témoigne. On valorise donc la réussite opérale. C'est bien une valeur relative à l'intérêt que l'on porte à une telle réussite, qui nous importe (sans quoi elle n'aurait pas de valeur). Mais d'autres intérêts, notamment moraux, entrent en jeu (pour prendre l'exemple de Schaeffer, je peux trouver qu'un livre est bien écrit et le trouver moralement détestable). Ces jugements portent sur l'objet, et comportent un intérêt, mais pas un intérêt esthétique ; ce ne sont donc pas des jugements esthétiques. On a donc une tendance à confondre jugements de goût et de réussite opérale (7), et cela peut nous amener à valoriser une oeuvre au nom de sa conformité à une norme (générique, par exemple, comme la règle des trois unités) : mais une oeuvre peut ne pas être conforme à la norme générique, mais être pourtant satisfaisante. Autrement dit, mon jugement esthétique trouve bien dans les propriétés objectales une cause nécessaire, mais non suffisante. Ce n'est donc pas parce que tel objet présente telle propriété qu'il faut l'apprécier de telle manière.
On pourrait conclure d'une telle analyse, un peu comme chez Genette, une totale perte de
légitimité pour la critique, puisque rien ne peut plus fonder épistémiquement son jugement, et
certainement pas les jugements de réussite opérale. Il n'en est rien, au contraire : "le
jugement esthétique du critique promeut des propriétés opérales qu'il considère comme
désirables, en vertu de l'appréciation qu'elles ont induite chez lui et dont il pense qu'il
serait avantageux (...) que d'autres individus les trouvent eux aussi désirables. (...) par
l'intermédiaire de la description du fondement causal de son appréciation esthétique, le
critique nous propose des pistes pour notre propre engagement esthétique, étant
entendu qu'il incombe à chacun d'expérimenter pour lui-même si la voie proposée lui
agrée ou non. Ce qui fait le prix d'un texte critique, ce n'est donc pas qu'il nous dise
comment il faut apprécier, mais qu'il nous indique les voies possibles d'une attention
esthétique satisfaisante ou qu'il nous amène à nous demander si nous ne nous
contentons peut-être pas de satisfactions bien maigres.
" (Schaeffer, 1996 : 247)
L'analyse de Schaeffer me semble donner des éléments très intéressants à une réflexion sur la critique. Par son empirisme, il reste au plus près des pratiques critiques, qu'une analyse détaillée et rigoureuse permet d'éclairer. Le refus des esthétiques objectivistes est en tout cas aussi central chez lui que chez Genette. Le jugement de goût est bien, comme l'avait montré Kant, un jugement relationnel. En ce sens, il est clairement subjectif car rien (du moins aucun concept) ne peut contraindre le sujet à une appréciation donnée. Un facteur pourtant fondamental conditionne le sujet : l'influence de la collectivité à laquelle il appartient. Mais pour Schaeffer, c'est le sujet même que ces conditionnement déterminent, et indirectement les appréciations et jugements, qui restent subjectifs.
Alors que Genette laissait de côté la distinction pourtant essentielle entre l'appréciation, le plaisir, d'une part, et le jugement d'autre part, Schaeffer insiste très justement sur ce point. Il montre bien comment l'un ne peut se réduire à l'autre, comment le jugement nécessite un dépassement de la satisfaction personnelle pour permettre d'énoncer un jugement de valeur. Mais en ramenant celui-ci à la simple énonciation solipsiste d'un intérêt personnel, en manquant le fait qu'un jugement de valeur ne peut que se fonder sur un partage intersubjectif de ces valeurs, sans quoi on en reste à l'incommunicable, Schaeffer ferme la porte à toute pensée de l'esthétique en termes de communication. C'est à ouvrir cette porte qu'on va maintenant s'atteler. Car Schaeffer, comme Genette, développent une énergie intellectuelle énorme à nier un fait pourtant évident : on discute des jugements de goût. Ainsi, le jugement est bien subjectif -- au sens de Kant, c'est-à-dire indéterminable par des concepts --, mais il n'est pas pour autant privé. Au contraire, et c'est en cela, selon moi, qu'il se distingue du plaisir, il est fondamentalement public.
Revenons à Kant un instant. Il écrit au �33 de la troisième Critique que "quand quelqu'un ne
trouve pas beau un édifice, un paysage, un poème, il ne se laisse pas imposer
intérieurement l'assentiment par cent voix, qui toutes, louent ces choses.
" Il peut bien le
faire par conformisme, par snobisme, mais Genette a fait remarquer l'insincérité de cet
amendement (cf. plus haut). Par là, Kant montre bien que, même si les goûts convergent, ils
sont subjectifs (on retrouve l'idée de � subjectivité collective �). Une convergence statistique
ne prouve absolument pas que l'objet doit nécessairement induire une satisfaction déterminée.
Plus loin, il écrit : "une preuve a priori d'après des règles déterminées peut encore moins
déterminer le jugement sur la beauté. Si quelqu'un me lit son poème, ou me conduit à
un spectacle, qui finalement ne convient pas à mon goût, il pourra bien invoquer
Batteux ou Lessing ou des critiques encore plus anciens et encore plus célèbres, ainsi
que toutes les règles établies par ceux-ci afin de prouver que son poème est beau ; il se
peut aussi que certains passages, qui justement me déplaisent, s'accordent parfaitement
avec les règles de la beauté (comme elles sont données par ces auteurs et généralement
re�ues) : je me bouche les oreilles, je ne veux entendre aucune raison, aucun argument
et j'admettrai plutôt que les règles des critiques sont fausses, ou du moins que ce n'est
pas ici qu'il faut les appliquer, que d'accepter que de laisser déterminer mon jugement
par des raisons démonstratives a priori, puisqu'il doit s'agir d'un jugement du goût et
non d'un jugement de l'entendement ou de la raison.
" Au paragraphe suivant, il écrit
encore cet autre passage significatif : "bien que, comme le dit Hume, les critiques sachent
tous en apparence mieux disserter que les cuisiniers, ils en partagent toutefois le destin.
Ils ne peuvent attendre la raison qui déterminera leur jugement de la force des
arguments, mais seulement de la réflexion du sujet sur son propre état (le plaisir ou son
contraire), abstraction faite de tout préceptes et de toutes règles.
" (CFJ, �34)
en pratique, on discute
effectivement des questions de
goût. Qu'aucun concept ne
puisse nous obliger à admettre
telle appréciation est assuré,
mais le débat esthétique se
base sur des arguments réels
qui
prétendent à une validité
intersubjective
Mais tout cela ne doit pas nous faire oublier un point essentiel : en pratique, on discute effectivement des questions de goût. Qu'aucun concept ne puisse nous obliger à admettre telle appréciation est assuré, mais le débat esthétique se base sur des arguments réels qui prétendent à une validité intersubjective. C'est là la pierre angulaire des thèses de Rainer Rochlitz, qui, s'opposant fermement au relativisme de Genette et Schaeffer, prétend que le jugement de goût n'est pas irrationnel. En fait, il se trouve soumis à un principe de � rationalité esthétique �.
1. Cette propriété de l'oeuvre n'est pas définitoire de l'art, et encore moins une propriété du beau. Elle définit un grand nombre d'autres artefacts non artistiques.
2. Genette défend une thèse similaire : "lorsque le sujet de cette relation [esthétique], à
tort ou à raison, et à quelque degré que ce soit, tient cet objet pour un produit humain
et prête à son producteur une � intention esthétique �, c'est-à-dire la visée d'un effet ou
la � candidature � à une réception esthétique, l'objet est re�u comme une oeuvre d'art,
et la relation se spécifie en relation, ou fonction, artistique.
" (Genette, 1997 : 275) Il faut
cependant remarquer que c'est ici le sujet qui reconnaît cette intention esthétique. L'intention
seule n'est donc pas suffisante : si, dans un geste duchampien, je dis d'un objet qu'il est une
oeuvre d'art, mais que cette � intention esthétique �, échappe à tous, il n'y a pas oeuvre d'art.
A fortiori, si je peins un tableau dans l'intention de réaliser une oeuvre d'art, mais que je le
laisse dans une armoire à l'abri d'autre regards, ce n'est pas alors une oeuvre d'art.
3. Cf. Kant : le jugement "ne contient qu'un rapport de la représentation de l'objet au
sujet
". (CFJ, �6)
4. Ici, on rejoint le deuxième sens, plus moderne, de cognition, que j'évoquais dans la note 2, dénotant toute relation de connaissance, y compris analogique et non déclarative.
5. C'est déjà ce que pensait Santayana, pour qui, s'il y a désintéressement, cela ne peut être
qu'en référence à un intérêt extérieur. Mais d'un point de vue interne, la relation esthétique est
intéressée en la reconduction du plaisir dont elle est le support. Avec son lyrisme habituel, il
écrit : "tout plaisir véritable est en un sens désintéressé. Il n'est pas recherché avec des
motifs ultérieurs, et ce qui emplit l'esprit n'est pas le calcul, mais l'image d'un objet ou
événement, baignant dans l'émotion.
" (Santayana, 1955, 25)
6. On pourrait bien voir là le fameux sens commun dont parlait Kant, mais je rappelle que ce ne peut être ce qu'il visait, puisque cette convergence de valeur ne constitue pas un principe a priori, ce qu'est le sens commun.
7. On retrouve sous une autre forme le glissement par Hume, dénoncé par Genette, du jugement de fait au jugement de valeur. Or, c'est une règle bien connue de la philosophie que pour déduire un principe normatif, il faut au moins une prémisse normative. D'un jugement de fait, on ne peut donc déduire un jugement de valeur.