1. Universalité et nécessité chez Kant
![]() ANS cette partie consacrée à Kant, je vais me pencher sur deux
notions clé de l'esthétique kantienne : l'universalité et la nécessité
du jugement de goût. La première section de la Critique Faculté de Juger esthétique
expose quatre caractéristiques du jugement de goût.
Je reprendrai ici trois d'entre elles, laissant de côté la notion de finalité
sans fin : avant de parler d'universalité et de nécessité, il faut en effet
évoquer le désintéressement.
ANS cette partie consacrée à Kant, je vais me pencher sur deux
notions clé de l'esthétique kantienne : l'universalité et la nécessité
du jugement de goût. La première section de la Critique Faculté de Juger esthétique
expose quatre caractéristiques du jugement de goût.
Je reprendrai ici trois d'entre elles, laissant de côté la notion de finalité
sans fin : avant de parler d'universalité et de nécessité, il faut en effet
évoquer le désintéressement.
Le premier moment de l'Analytique du Beau fait ressortir deux traits essentiels du jugement esthétique.
le jugement de goût
n'est donc
pas un jugement de
connaissance ; par conséquent
il n'est
pas logique, mais
esthétique ; esthétique
signifie : ce dont le principe
déterminant ne peut être que
subjectif.
Le premier est la subjectivité du jugement de goût : "le jugement de goût
n'est donc pas un jugement de connaissance ; par conséquent il n'est
pas logique, mais esthétique ; esthétique signifie : ce dont le principe
déterminant ne peut être que subjectif.
" (CFJ �1)
Le deuxième trait est le désintéressement : "la satisfaction qui détermine
le jugement de goût est désintéressée. (...) Lorsque (...) la question est
de savoir si une chose est belle, on ne désire pas savoir si
nous-mêmes, ou toute autre personne portons ou même pourrions
porter un intérêt à l'existence de la chose, mais comment nous la
jugeons en la considérant simplement (qu'il s'agisse d'intuition ou de
réflexion).
" (CFJ �2). Que la satisfaction soit désintéressée, cela veut dire
que je considère la représentation de son objet pour elle-même, que peut
m'importe l'existence même de son objet : je puis bien éprouver une
satisfaction esthétique face à des objets purement fictionnels, voire, en
référence aux nouvelles technologies, virtuels.
Mais par son désintéressement, la satisfaction esthétique se distingue aussi
des satisfactions liées d'une part à l'agréable, d'autre part au bien. Dans
ces cas-ci, la satisfaction est liée à un intérêt dans l'existence de l'objet :
"celle-ci n'est pas seulement déterminée par la représentation de
l'objet, mais encore par celle du lien qui attache le sujet à l'existence
de l'objet. Ce n'est pas seulement l'objet, mais aussi son existence qui
plaît.
" (CFJ, �5)
Le jugement d'agrément est intéressé en ce qu'il dépend
du désir de l'objet, dont la satisfaction est accordée par la sensation : "que
mon jugement, sur un objet que je déclare agréable, exprime un
intérêt pour celui-ci, cela est clair par le simple fait qu'il suscite par la
sensation un désir pour les objets semblables. Par conséquent la
satisfaction ne suppose pas seulement le simple jugement sur l'objet,
mais encore la relation de l'existence de cet objet à mon état, dans la
mesure o� je suis affecté par un tel objet.
" (CFJ �3) Remarquons que
le jugement d'agrément et le jugement esthétique ont en commun le fait
qu'ils sont tous deux subjectifs.
Le jugement porté sur le bien est intéressé en ce qu'il se rapporte à un concept du bien. Ce bien (ou bon) prend deux formes : le bon-à-quelque-chose, dans lequel un intérêt est lié à l'utilité de l'objet du jugement, à sa capacité à remplir une fin ; et le bon-en-soi, qui plaît par lui-même, mais relativement à une fin déterminée par un concept du bien. (CFJ �4)
le jugement esthétique est
purement contemplatif, ne
porte que sur l'aspect de
l'objet, indépendamment de
tout intérêt qui
pourrait lui
être lié
Ainsi désintéressé, le jugement esthétique est purement contemplatif, ne
porte que sur l'aspect de l'objet, indépendamment de tout intérêt qui
pourrait lui être lié : "le jugement de goût est seulement contemplatif ;
c'est un jugement qui, indifférent à l'existence de l'objet, ne fait que
lier sa nature avec le sentiment de plaisir et de peine.
" (CFJ �5) Il ne
porte que sur une "pure et simple représentation
". Le terme
Beschaffenheit, traduit ici par � nature
�, peut aussi être traduit par
� conformation
�, ou encore manière d'être, de se présenter. Cette
contemplation n'est en outre pas soumise à un concept, qui ne peut en être
ni le fondement, ni le but : je n'énonce pas un jugement sur le beau en
réponse à un concept du beau, ni dans le but de produire un tel concept.
Ainsi, contrairement aux trois autres sortes de satisfactions (le bon, l'utile,
l'agréable), le sentiment du beau est libre : il n'est pas possible d'en forcer
l'assentiment par la raison.
On peut encore distinguer le jugement esthétique d'un autre type de jugement, non plus, cette fois, sur la base de l'intérêt lié à la satisfaction, mais sur la base de la subjectivité ou de l'objectivité du jugement. Ce type de jugement désintéressé est relatif à la faculté de connaître. Mais quoiqu'il partage le désintéressement du jugement esthétique, il est objectif : il porte sur la subsomption de la représentation de l'objet sous un concept par les voies de l'entendement et de l'imagination. Cette opération est objective car le concept s'impose au sujet (une règle mathématique, par exemple).
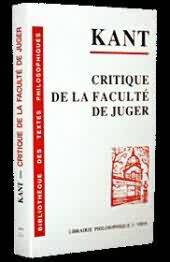
Critique de la faculté de
juger
Puisque la satisfaction est désintéressée, le jugement esthétique fait l'objet d'une prétention à l'universalité. Ce principe est énoncée de la manière la plus explicite dans le �6 de la CFJ. Ce texte est d'une importance fondamentale pour le projet dans lequel s'inscrit ce travail. Je me permets donc de le citer presque in extenso.
Le beau est ce qui est représenté sans concept comme
objet d'une satisfaction universelle. (...) Car qui a
conscience que la satisfaction produite par un objet est
exempte d'intérêt, ne peut faire autrement qu'estimer que
cet objet doit contenir un principe de satisfaction pour
tous. En effet, puisque la satisfaction ne se fonde pas sur
quelque inclination du sujet (ou quelque autre intérêt
réfléchi), mais qu'au contraire celui qui juge se sent
entièrement libre par rapport à la satisfaction qu'il prend
à l'objet, il ne peut dégager comme principe de la
satisfaction aucune condition d'ordre personnel, dont il
serait seul à dépendre comme sujet. Il doit donc
considérer que la satisfaction est fondée sur quelque
chose qu'il peut aussi supposer en tout autre. Et par
conséquent, il doit croire qu'il a raison d'attribuer à
chacun une satisfaction semblable. Il parlera donc du
beau, comme si la beauté était une structure de l'objet et
comme si le jugement était logique (et constituait une
connaissance de celui-ci par des concepts de l'objet),
alors que le jugement n'est qu'esthétique et ne contient
qu'un rapport de la représentation de l'objet au sujet ;
c'est que le jugement esthétique ressemble toutefois en
ceci au jugement logique qu'on peut le supposer valable
pour chacun. (...) Il s'ensuit que la prétention de posséder
une valeur pour tous doit être liée au jugement de goût et
à la conscience d'être dégagé de tout intérêt, sans que
cette prétention dépende d'une universalité fondée
objectivement ; en d'autres termes, la prétention à une
universalité subjective doit être liée au jugement de
goût.
Ainsi, en formulant un
jugement de goût, le sujet
suppose en droit que
chacun
partagera ce jugement.
Pourtant, le jugement n'en est
pas moins
subjectif
Ainsi, en formulant un jugement de goût, le sujet suppose en droit que chacun partagera ce jugement. Pourtant, le jugement n'en est pas moins subjectif. Mais par son universalité, il pourrait être confondu avec le jugement de connaissance. Kant précise donc que, contrairement à ce dernier, aucun concept ne peut venir justifier le jugement de goût. Il n'existe aucune règle à laquelle on puisse se référer pour justifier la vérité d'un jugement de goût comme il en existe en ce qui concerne la connaissance.
Le jugement de goût est donc lié à l'expérience de la société. Paul Guyer
(1997) montre que Kant, dans ses premier textes, ne pouvait concevoir de
plaisir esthétique dans une situation d'isolation sociale. Il semble
raisonnable de penser que le jugement de goût, dans la mesure o� il
concerne la manière dont un objet plaît aux autres, ne peut se produire
qu'en société. "Le goût, en temps que capacité à juger la validité
intersubjective du plaisir, peut de toute évidence exiger un véritable
calcul sur la manière dont un objet va affecter les autres, et si un tel
calcul peut être fait uniquement en référence à des lois connues
empiriquement à propos de soi-même et des autres, alors le jugement
de goût peut exiger une véritable expérience de la société.
" (Guyer,
1997 : 20) Mais dans un texte � pré-critique � Kant dit aussi que dans le
cas du goût, le plaisir lui-même surgit en accord avec des lois empiriques.
Ce n'est donc pas seulement le jugement qui suppose une universalité, mais
le plaisir lui-même. "Ni un objet du goût, ni l'état mental qu'il
occasionne, (...) n'est la cause directe de notre plaisir dans le beau.
C'est seulement la généralité de l'état mental, l'accord entre soi-même
et les autres, que l'occurrence de l'état représente, qui est maintenant
supposé être le fondement de la réaction esthétique [�sthetic
response]. Selon un autre passage, le beau est � ce qui plaît parce
qu'il plaît aussi aux autres.
" (id.)
L'universalité subjective n'aurait donc pas seulement un rôle de critère pour
l'énoncé d'un jugement ; il serait à la base même, non seulement du
jugement, mais aussi du plaisir esthétique proprement dit. Dans un état
d'isolement, il ne peut y avoir aucun plaisir esthétique. "Ce n'est pas un
état mental en soi mais la validité générale qui cause le plaisir ; et
c'est de cette thèse que Kant dérive la conclusion frappante que dans
des circonstances dans lesquelles aucune connaissance de validité
intersubjective n'est possible, il ne peut y avoir non seulement aucun
jugement de goût, mais aussi aucun plaisir dans le beau.
" (Guyer,
1997 : 21)
si je formule un jugement,
� cela est beau
�,
je me réfère
implicitement aux autres, dont
je suppose qu'ils partageront
mon avis, puisque je le
suppose universellement
valable.
Dans la Critique de la faculté de juger, Kant introduit une distinction
entre plaisir et jugement esthétique qui lui permet de revenir sur ces
conclusions curieuses. On peut en effet difficilement accepter qu'on ne
puisse éprouver de plaisir en dehors de l'expérience sociale. Seul, je puis
parfaitement éprouver du plaisir, autant un plaisir des sens qu'un plaisir
esthétique. Je n'ai besoin de la reconnaissance de personne pour dire :
� cela me plaît
�. En revanche, si je formule un jugement, � cela est beau
�,
je me réfère implicitement aux autres, dont je suppose qu'ils partageront
mon avis, puisque je le suppose universellement valable. Je ne puis
énoncer un jugement si en même temps je reconnais qu'il ne peut être
reconnu par tout un chacun, qu'il n'est valable que pour moi-même. Ce
n'est alors pas un jugement, mais l'aveu d'une simple préférence
personnelle. Dans ce cas, je ne déclare rien concernant l'objet lui-même, je
ne le juge pas, ne l'évalue pas. Je ne fais que dire qu'il me plaît. Mais parler
du beau suppose nécessairement l'universalité. Comme l'écrit Kant : "cette
prétention à l'universalité appartient si essentiellement à un
jugement, par lequel nous affirmons que quelque chose est beau, que
si l'on ne pensait pas à celle-ci, il ne viendrait à personne à l'idée
d'user ce terme ; on mettrait donc au compte de l'agréable tout ce qui
plaît sans concept.
" (CFJ, �8)
Le jugement esthétique se distingue du jugement sur l'agréable en ce que
lorsque j'énonce un jugement de la forme : � cela m'est agréable
�, je ne
parle qu'en mon nom propre, et ne m'attend aucunement à ce qu'un autre
partage nécessairement mon avis : "lorsqu'il s'agit de ce qui est
agréable, chacun consent à ce que son jugement, qu'il fonde sur un
sentiment personnel et en fonction duquel il affirme d'un objet qu'il lui
plaît, soit restreint à sa seule personne.
" (CFJ, �7) En revanche, en ce
qui concerne le beau, le jugement prétend à une validité intersubjective, et
c'est précisément ce qui le distingue du jugement sur l'agréable : "il en va
tout autrement du beau. Il serait (...) ridicule que quelqu'un
s'imaginant avoir du goût songe à en faire la preuve en déclarant :
cet objet (...) est beau pour moi. Car il ne doit pas appeler beau ce qui
ne plaît qu'à lui.
" (CFJ, �7)
Kant relève donc deux types de goûts, l'un, purement individuel, l'autre,
prétendant à l'universalité. Le jugement de goût (universel) n'en est pour
autant pas moins subjectif. Il n'est pas logique, car de l'universalité
subjective je ne peux tirer aucune règle. Le prédicat de beauté n'est pas lié
au concept de l'objet (auquel cas la beauté en serait une propriété), mais à
tous les sujets qui jugent, dont on suppose l'accord. Le jugement est
universel, mais sans concept. Ce n'est pas parce que je juge un objet beau
qu'on peut déduire une loi selon laquelle l'objet est beau (objectivement).
Par contre, si, pour suivre toujours Kant, à partir de l'observation
empirique d'une convergence de jugements, j'énonce la loi selon laquelle
� toutes les roses sont belles
�, je ne fais pas un jugement esthétique, mais
un jugement logique. Donc, "dès que l'on porte un jugement sur des
objets uniquement d'après des concepts, toute représentation de
beauté disparaît. On ne peut donc indiquer la règle d'après laquelle
quelqu'un pourrait être obligé de reconnaître la beauté d'une chose.
"
(CFJ, �8) Il n'existe donc aucun concept, aucune règle qui puisse justifier
la prétention à l'universalité du jugement. Celle-ci ne peut être confirmée
logiquement : "on postule la possibilité d'un jugement esthétique qui
puisse être considéré comme valable en même temps pour tous. Le
jugement de goût ne postule pas lui-même l'adhésion de chacun (...), il
ne fait qu'attribuer à chacun cette adhésion comme un cas de la règle
dont il attend la confirmation de l'accord des autres et non pas de
concepts.
" (CFJ, �8)
Le jugement de goût ne postule donc rien d'autre que son universalité
subjective, "la possibilité d'un jugement esthétique qui puisse être
considéré comme valable en même temps pour tous.
" (CFJ, �8) On ne
postule pas l'adhésion de chacun, ce que seul un jugement logique peut
faire (lorsque je dis que la terre est ronde, j'énonce une règle qui s'impose
à tous), mais j'attribue seulement cette adhésion (lorsque je dis que cette
oeuvre est belle, je suppose que chacun est d'accord).
Par ailleurs, il y a une propriété du jugement de goût qu'évoque Kant, sur
laquelle il ne s'étend pas, mais qui me semble très importante, et que
d'autres, comme Santayana, puis Genette, vont développer. Dans le �6
cité plus haut, Kant écrit : "il parlera donc du beau, comme si la beauté
était une structure de l'objet et comme si le jugement était logique
".
Un paragraphe plus loin, il écrit : il "parle alors de la beauté comme si
elle était une propriété des choses.
" C'est là une caractéristique
importante du jugement esthétique. Quand bien même il est subjectif, le
sujet qui l'énonce le fait comme s'il le déduisait de propriétés de l'objet. Ce
point est important, car il est en quelque sorte la trace linguistique de la
prétention à l'universalité. "Nous adoptons dans ce cas un mode
d'expression grammaticalement objectif parce que nous prétendons
en fait au même statut de validité intersubjective pour certains de nos
sentiments que pour nos perceptions de leurs propriétés ordinaires.
Quand j'appelle quelque chose rouge, je ne fais pas que décrire
comment il m'apparaît -- ce que je fais en disant �
" (Guyer, 1997 : 119) On verra au
chapitre suivant comment Genette reprend cette notion de
l'� objectivation � du jugement. Il en fait, plus que Kant lui-même, le
fondement de la communication de celui-ci.cela semble
rouge
� -- mais je décris plutôt comment je m'attends à ce qu'il
apparaisse à quiconque dans certaines circonstances, en vertu de
certaines propriétés spécifiques. Quand j'appelle quelque chose beau,
je ne dis pas de la même manière qu'il me plaît, mais plutôt qu'il
devrait plaire à quiconque le per�oit.
Ceci nous montre cette caractéristique remarquable du jugement de goût,
qui est de prétendre valoir pour tous, et donc être communicable, ce qui
n'est pas le cas d'une simple sensation d'agrément. Mais cette
communication est toute particulière, car elle est subjective, n'est fondée
sur aucun concept. On se trouve donc devant cette situation tout à fait
singulière o� un jugement prétend à l'universalité, mais o� il n'exprime
pourtant que le sentiment du sujet, sans que celui-ci ne puisse jamais en
apporter la moindre preuve, sauf, précisément, à ne plus parler de beauté :
"il faut tout d'abord se convaincre entièrement que par le jugement
de goût (sur le beau) on attribue à tout un chacun la satisfaction
procurée par un objet, sans se fonder cependant sur un concept (en ce
cas il s'agirait du bien), -- et que cette prétention à l'universalité
appartient si essentiellement à un jugement, par lequel nous
affirmons que quelque chose est beau, que si l'on ne pensait pas à
celle-ci, il ne viendrait à personne à l'idée d'utiliser ce terme ; on
mettrait au compte de l'agréable tout ce qui plaît sans concept.
"
(CFJ, �8)
Le jugement de goût prétend
non seulement à
l'universalité,
mais il est
aussi nécessaire, c'est-à-dire
soumis à une obligation : "le
beau
possède une relation
nécessaire à la
satisfaction.
La dernière caractéristique du jugement de goût dont il sera question ici est
la nécessité. Le jugement de goût prétend non seulement à l'universalité,
mais il est aussi nécessaire, c'est-à-dire soumis à une obligation : "le beau
possède une relation nécessaire à la satisfaction.
" (CFJ, �18) Mais il
s'agit d'une nécessité d'un genre particulier. D'abord, ce n'est pas une
nécessité théorique, qualifiant un principe a priori : je ne peux supposer
l'accord en goût a priori ; ce n'est qu'à travers un concept que cela serait
possible. Ce n'est pas non plus une nécessité pratique (=morale) : le
jugement de goût ne prescrit pas une manière d'agir selon les "concepts
d'une pure volonté rationnelle
". C'est une nécessité exemplaire : "c'est
la nécessité de l'adhésion de tous à un jugement, considéré comme un
exemple d'une règle universelle que l'on ne peut énoncer.
" (CFJ, �18)
Cette nécessité, puisqu'elle n'est pas théorique, n'est pas non plus
apodictique, puisqu'on ne peut la déduire de concepts. Elle ne peut pas
plus être conclue de l'expérience : même si un jugement de goût rencontre
une convergence large (ce qui est plus courant que Kant ne l'admet (1)),
cette convergence n'est pas une raison suffisante pour fonder la nécessité.
Si tout le monde trouve belle la Sonate au clair de Lune de Beethoven,
ce n'est pas là la raison pour laquelle on peut dire que ce jugement est
nécessaire.
Cette nécessité, exemplaire, mais aussi subjective (puisqu'il s'agit de
jugement de goût), est donc conditionnée : "celui qui déclare une chose
belle estime que chacun devrait donner son assentiment à l'objet
considéré et aussi le déclarer comme beau.
" (CFJ, �19)
Si la nécessité du jugement de goût est subjective, exemplaire et
conditionnée, à quelle condition, précisément, répond-elle, sur quoi se
base-t-elle ? Pour Kant, il s'agit du � sens commun �. Les jugements de
goûts "doivent donc posséder un principe subjectif, qui détermine
seulement par sentiment et non par concept, bien que d'une manière
universellement valable, ce qui plaît ou déplaît. Un tel principe ne
pourrait être considéré que comme un sens commun, qui serait
essentiellement distinct de l'entendement commun.
" (CFJ, �20) Donc,
pour Kant, cette nécessité "découle de la validité universelle du beau,
et dépend de la présupposition qu'il y a un � sens commun �, ou
condition subjective partagée de la connaissance, à la base de la
finalité formelle.
" (Guyer, 1997 : 113)
La notion de sens commun est d'une grande importance dans l'esthétique
kantienne. Sans lui, on ne pourrait fonder la nécessité de ce jugement, ni
son universalité : comment se pourrait-il qu'un jugement particulier soit
imputable à tous, sans présupposer un principe commun auquel tous sont
sujets ? En effet, la nécessité impose au jugement une caractéristique
supplémentaire à sa seule validité universelle. Cette prétention n'est pas
une prédiction, ne dit pas seulement que chacun admettra le jugement,
mais que chacun devrait l'admettre, et cela parce qu'il a une valeur
exemplaire. "Car tel est
, écrit Guillermit, le sens de cette communauté
de sentiment qui en est le principe subjectif : du fait même que mon
jugement n'est qu'un cas d'une règle idéale, il devrait pouvoir faire
l'unanimité.
" (Guillermit, 1981 : 99) Pour Kant, évidemment, cela ne
signifie nullement que tout jugement est effectivement nécessairement
partagé. Mais ce qui est certain, c'est qu'en jugeant un objet beau, le sujet
rapporte son jugement à l'Idée (2) de l'universalité, car celui-ci est
désintéressé, et diffère du jugement sur le bien et sur l'agréable.
Si le jugement de goût ne dépend d'aucun concept, nous ne permettons
pourtant pas à d'autres d'avoir une opinion différente de la nôtre (CFJ,
�22). Cette assertion peut paraître quelque peu excessive, mais on peut la
lire ainsi : quoique je puisse bien avoir assez de respect pour les opinions
d'autrui, du fait que je considère mon jugement comme universellement
valable et nécessaire, je l'estime aussi comme le seul juste, puisque je
considère mon jugement comme accordé à une norme universelle. Je ne
puis pas aimer et ne pas aimer en même temps un objet, sous prétexte
qu'un autre a un avis contraire au mien. Mon avis est bien le mien, et si un
autre ne le partage pas, je considère qu'il doit d'une manière ou d'une autre
avoir tort, d'o� le débat critique, par lequel je tenterai de montrer que mon
jugement est le bon, que c'est une question de � bon sens � -- pour
prendre une formule commune qui n'a rien de kantien -- et bien que tout
cela soit illusoire -- aucun jugement de goût n'est démontrable, bon ou
juste. Le jugement de goût est fondé sur un sentiment, non pas seulement
personnel, mais commun. Ce sens commun "ne dit pas que chacun
admettra notre jugement, mais que chacun doit (3) l'admettre. Ainsi le
sens commun, dont je donne comme exemple mon jugement de goût,
lui conférant, pour cette raison, une valeur exemplaire, est une simple
norme idéale.
" (CFJ, �22) Dès lors, tout jugement qui s'accorderait à
cette norme idéale, ainsi que la satisfaction qui s'attache à son objet
pourrait être érigé en règle pour chacun. Comme ce principe est
subjectivement universel, il pourrait exiger un assentiment universel, au
même titre qu'un jugement objectif, pourvu que l'on soit sûr d'avoir
correctement subsumé sous ce principe. Et le droit que nous prenons de
porter des jugements de goût prouve que nous supposons effectivement
une telle norme d'un sens commun (4).
Kant me semble avoir remarquablement posé les problèmes que rencontre la philosophie de la critique. Il rend compte non seulement de la subjectivité du jugement de goût (contre les thèses objectivistes, qui attribuent la beauté à l'objet lui-même), mais aussi de la réalité du débat critique, qui tente de dépasser cette subjectivité, grâce aux notions d'universalité et de nécessité. Mais ceci, il le fait au prix d'hypothèses parfois difficiles à défendre encore aujourd'hui. La prétention légitime à l'universalité découle, on l'a vu, du désintéressement. Mais un jugement peut être désintéressé et néanmoins idiosyncrasique. D'autres facteurs que l'intérêt peuvent rendre un jugement singulier : la situation, l'humeur du jour... Quant au sens commun, s'il est une hypothèse très forte, elle reste difficile à vérifier empiriquement. En droit, Kant peut bien postuler ce sens commun, mais en fait, on se demande s'il existe bel et bien. On pourrait bien déduire l'existence d'un sens commun des convergences nombreuses que l'on trouve en matière d'art, notamment sur ce qu'on admet comme chef-d'oeuvre. Mais il s'agit là d'une observation empirique, et Kant, on le sait, refuse de tirer d'un fait empirique une règle a priori, ce qu'est le sens commun, normatif et présupposé.
1. "L'expérience nous fournirait difficilement beaucoup d'exemples
d'un pareil accord.
" (CFJ, �18)
2. Chez Kant, une Idée est une exigence de la raison.
3. Ou plutôt devrait l'admettre. Il s'agit d'une nécessité conditionnée.
4. Pour ce dernier point, je me suis fortement aidé de la traduction proposée par Florence Khodoss, dans la collection de textes issus de la CFJ titrée Le jugement esthétique (Presses Universitaires de France), beaucoup plus claire ici que celle d'Alexis Philonenko (Kant, 1955).