La narration dans "Lost Highway"
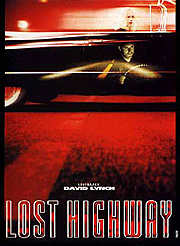
"Lost Highway"
[...] brouille
les pistes temporelles...
![]() IEN
PLUS fondamentalement qu'une histoire de schizophrénie,
de crise d'identité ou de violence humaine, "Lost
Highway" (1996, David
Lynch) est une réflexion/remise en question de la narration
et de la place de l'auteur/créateur par rapport à
sa création.
IEN
PLUS fondamentalement qu'une histoire de schizophrénie,
de crise d'identité ou de violence humaine, "Lost
Highway" (1996, David
Lynch) est une réflexion/remise en question de la narration
et de la place de l'auteur/créateur par rapport à
sa création.
On se souvient des démarches formalistes extrêmes à la suite de la nouvelle vague. Sur le plan du temps au cinéma, "L'Année dernière à Marienbad" de Resnais et Robbe-Grillet fait figure d'anthologie.
"Lost Highway", on s'en aperçoit très vite, brouille les pistes temporelles sans doute plus encore que le film français, mais avec une démarche fort différente.
Il faut avant toute chose se rappeler que ce qu'on appelle narration comporte trois aspects différents : l'histoire proprement dite (le contenu), la forme que prend l'expression de cette histoire, et l'acte de la raconter. La typologie proposée par Gérard Genette a été largement adoptée. Voici ce qu'il en dit :
Je propose (...) de nommer histoire
le signifié ou contenu narratif (...), récit
proprement dit le signifiant, énoncé, discours ou texte
narratif lui-même, et narration l'acte
narratif producteur et, par extension, l'ensemble de la situation réelle
ou fictive dans laquelle il prend place.(1)
Dans cette analyse, je ne m'en tiendrai qu'aux aspects formels, couverts par les deux premières catégories : l'histoire, et le récit qui lui donne sa forme.
On peut donc dire que toute fiction racontée est soumise à deux temps : le temps du récit (TR) et le temps de l'histoire (TH) :
- le temps du récit est le temps effectivement écoulé pour narrer l'histoire : les deux heures d'un film, les deux cents pages d'un roman. On l'appelle aussi temps externe. Il s'apparente à la forme et au plan du discours.
- le temps de l'histoire est le temps interne, c'est à dire le temps qui s'écoule à l'intérieur même de la fiction : un jour, une nuit, un siècle, peuvent être condensés en deux heures. Il s'apparente au contenu et au plan des événements.
Le TR est traditionnellement une réplication, une copie plus ou moins fidèle du TH. En effet, de la fiction et de son déroulement, on ne garde que certains éléments, certaines scènes, qu'il est utile de narrer. On fait ainsi des sauts dans le temps (ellipses), et des retours en arrière (flashback), lorsque la chronologie du TH relative à deux événements est permutée dans la copie qu'est le TR (comme une photo qu'on tire en retournant le négatif).
Dans "Lost Highway", les pôles sont inversés. Le TH est une copie du TR. C'est une temporalité formelle, qui impose le déroulement de la fiction. Les personnages et les événements, soumis à un temps interne qui, de l'intérieur, est cohérent, suivent cette temporalité qui elle, est à son tour soumise aux vicissitudes de la narration, de l'acte de raconter.
Jusqu'à présent, ça peut paraître un peu tordu, mais on peut vite remarquer que ce modèle s'applique à toute la narration, et pas seulement à son temps, sur lequel elle s'appuie néanmoins.
Dans son livre "Filmmaking : narrative and structural techniques", Bob Foss distingue le Plan des Événements (PE), qui correspond au contenu (plan du contenu), à ce qui est effectivement raconté, et le Plan du Discours (PD), qui correspond à la forme, à la manière de raconter (plan de l'expression). Si tous les éléments de chaque plan sont accessibles l'un à l'autre au sein du même plan, les deux plans sont normalement rigoureusement hermétiques.
Ce que les Madison regardent,
ce n'est autre que le film
lui-même, le film que nous,
spectateurs, regardons.
Dans "Lost Highway", la barrière qui sépare les deux plans fuit de toute part. Par exemple, les cassettes vidéo que Renée Madison trouve au pas de sa porte. Personne ne semble les avoir filmée. Il n'y a pas d'effraction dans la maison, les Madison n'ont vu personne. Et pourtant quelqu'un les a bel et bien filmée. C'est l'auteur. Ce que les Madison regardent, ce n'est autre que le film lui-même, le film que nous, spectateurs, regardons. La manière dont sont filmés ces plans vidéo est significative. Il sont filmés en plongée, comme si la caméra volait, comme si celui qui filme appartenait à un autre monde, et ne faisait qu'observer un monde qui n'est pas dans sa nature, d'où cette image brouillée. En outre, après un plan montrant le film vidéo sur l'écran de télé, ce film emplit tout l'écran de cinéma, il s'impose au film lui-même ("Lost Highway"), cet élément du PE remonte dans le PD.
N'oublions pas l'homme mystérieux, qui est omnipotent, omniscient et surtout, doué d'ubiquité. Ce sont là les qualités de l'auteur vis-à-vis de son œuvre. De fait, cet homme n'est autre que l'auteur plongé au sein de sa propre création. Et lorsque, à la fin du film, Fred Madison réapparaît, dans le désert, il se retrouve confronté l'homme mystérieux, puis le fuit, comme s'il était menacé par cet être étrange qui ne fait que le filmer avec une caméra vidéo, arme suprême, et le poursuit jusqu'à la voiture que Fred parvient à faire démarrer à la dernière minute. Fred fuit en fait l'auteur qui veut filmer, veut mettre en image, et on s'est vite rendu compte de la prépondérance de l'image dans le film, il veut se soustraire à cette volonté qui se joue de lui, il ne supporte plus le poids de ces actes qu'il n'a pas conscience de commettre (surtout le meurtre de sa femme).

Fred, Alice, Renée ?
D'ailleurs, l'image filmée par cette caméra, par
l'homme mystérieux, emplit un moment tout l'écran,
comme les images des cassettes vidéo du début. Un
plan montre l'homme "armé" de sa caméra
et le montre de face, un oeil grand ouvert, l'autre vissé
au viseur, figurant ainsi la vision de l'histoire et sa mise en
image, le fond et la forme, l'auteur omnipotent et sa création
profondément remise en question dans son rapport à
son "géniteur" : quand Fred fuit l'homme mystérieux,
celui-ci lui demande "Et vous, quel est votre
nom ?
" (après lui avoir soutenu que la femme qu'il
cherchait ne s'appelait pas Alice, mais Renée), c'est à
dire "qui êtes-vous, ici ?
".
Et entre Pete Dayton et Fred Madison, on ne sait pas qui est la
création/créature, malléable (au sens propre
comme au sens figuré), interchangeable. On a souvent parlé
de crise d'identité dans "Lost Highway", et c'est
là que se trouve le coeur de cette crise.
C'est sans doute plus l'exécution de Mr. Eddy que le "Dick
Laurent is dead
" professé dans l'interphone
qui boucle la boucle. Avant de mourir, Dick Laurent/Mr. Eddy,
en effet, peut se voir filmé par l'homme mystérieux
EN DIRECT, et non plus en différé, comme c'était
le cas avec les cassettes vidéo. Et cette fusion n'est
pas que temporelle, mais aussi spatiale, puisque l'homme mystérieux
n'a plus besoin de jouer sur son ubiquité. Fiction et narration
se rencontrent dans ce petit écran de télé
miniature, en ce sens que l'acte de filmer produit simultanément
et conséquemment une image au sein de la fiction, alors
que normalement, la relation est non seulement inverse, mais aussi
différée. La conception traditionnelle du film veut
en effet qu'une fiction produise a posteriori les images d'un
film. Dans "Lost Highway", narration (de l'auteur),
fiction (des personnages) et perception (du spectateur) sont fusionnés
en un seul et même instant.
Quant à la mystérieuse disparition de Pete Dayton, je croirais volontiers qu'il a été aspiré hors du plan des événements, vers le plan du discours, puis a été reprojeté dans la fiction, mais pas à la bonne place.
..."Lost Highway"
[...] suscite
des questionnements sans fin
chez le spectateur [...] forcé
à une attitude active...
Le procédé général est, en gros, identique
à celui d'un film burlesque où un personnage s'exclamerait
"j'espère que le scénariste a prévu
ceci...
", ou bien où le réalisateur
apparaîtrait lui-même. Encore que dans ce dernier
cas, ce réalisateur serait personnifié, caractérisé,
et dès lors ne serait plus le réalisateur, dont
il n'aurait plus que le rôle. Dans "Lost Highway",
l'auteur/réalisateur/créateur reste à sa
place, mais "se délègue" dans un personnage
mystérieux.
Remarquons enfin que "Lost Highway" a cette qualité d'être un film proprement cinématographique. En aucun cas l'histoire de ce film n'aurait pu être raconté dans un autre média. Raconter par écrit l'épisode des cassettes vidéo n'aurait sans doute rien voulu dire. Elles n'auraient correspondu à aucun film, comme c'est le cas ici.
Et aussi reconnaissons à "Lost Highway" cette qualité rare : il suscite immanquablement des questionnements sans fin chez le spectateur, qui, cherchant en vain à comprendre, est forcé à une attitude active bien plus intéressante que l'attitude passive engendrée de l'immense majorité des autres films.